|
[ ÉDITORIAL ]
|
|
Pharmacie : rien ne va plus !
Toutes les composantes de la profession pharmaceutique ont présenté, le mardi 5 juillet, un manifeste pour attirer l’attention des décideurs politiques et de l’administration sur la situation délicate que connaît la pharmacie en France.
Ce manifeste qui a été signé par les représentants des trois syndicats de pharmaciens, les différents conseils, les groupements et les étudiants en pharmacie, traduit la détermination des pharmaciens à refuser de faire les frais du projet de la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2017. Les négociations pour la prochaine convention pharmaceutique qui sera finalisée en avril 2017 s’annoncent âpres.
Dans un premier temps, les représentants des pharmaciens exhortent le gouvernement à s’engager avant le PLFSS à fixer un cadre économique clair. Ils estiment que ce cadre est un prérequis à l’ouverture de la négociation de la convention nationale pharmaceutique qui va durer 5 ans.
Dans leur manifeste, les pharmaciens ont réitéré leur volonté de conforter leur place dans l’observance et le bon usage du médicament, de renforcer leur rôle dans la prise en charge des personnes âgées en ville et en EHPAD, de développer les actions de prévention et de dépistage à l’officine, d’organiser la continuité ville-hôpital, de développer la coordination entre les différents professionnels de santé et d’obtenir une rémunération adaptée à ces nouvelles missions.
En parallèle à cette action, les pharmaciens vont entamer une campagne destinée au grand public. Des affiches rappelant les missions des pharmaciens avec l’accroche : « Et si demain tout cela disparaissait », ont été confectionnées et devraient être placardées dans toutes les officines françaises.
Les pharmaciens français parlent aujourd’hui la même voix, sous l’égide de l’Union des Pharmaciens Français, et cela est un atout de taille pour qu’ils puissent préserver leur profession. Seulement, cette union suffira-t-elle à mettre fin aux faillites et fermetures qui se poursuivent à raison d’une pharmacie tous les deux jours et demi ? Rien n’est moins sûr.
La profession pharmaceutique a de plus en plus de mal à trouver ses marques. La recherche de l’équilibre financier a tendance à éloigner, le pharmacien du cœur de son métier. Pour de nombreux experts, la pérennité de la profession passe par une vraie mutation avec une phase transitoire très complexe. C’est sans doute le prix à payer pour ne pas rester tributaire d’une marge commerciale qui est de moins en moins du goût des organismes payeurs.
Au Maroc, la crise économique des officines ne fait aucun doute. Mais en l’absence de chiffres et de vraies études pour évaluer la situation économique de l’officine, la profession continue à naviguer à vue. Le dernier exemple en date est la convention du tiers payant qui rentrera en vigueur dans quelques jours. Les signataires de cette convention n’ont malheureusement pas pris en considération certains aspects pratiques de l'application de cette convention. Par conséquent, seuls 33 pharmaciens ont fait les démarches nécessaires pour pouvoir pratiquer le tiers payant. Car, dans les faits, la plupart des pharmaciens n’ont aucune envie de se déplacer à la CNOPS pour déposer les dossiers de prise en charge des patients. Ceci vient s’ajouter à l’absence de système de télétransmission des données relatives aux dossiers tiers payant et à la non rentabilité des médicaments concernés par la convention.
Enfin, on ose espérer que l’enthousiasme des protagonistes d’une convention de tiers payant généralisée ne leur fasse pas oublier la nécessité de faire des études d’impact pour ne pas compromettre la survie d’une profession au bord du précipice.
Abderrahim DERRAJI
|
|
|
Revue de presse

|
 Les sacs en plastique font de la résistance
Les sacs en plastique font de la résistance
Malgré leur interdiction depuis le 1er juillet, les sacs plastiques continuent d’être utilisés. Si les grandes surfaces se sont mises en conformité avec la loi en proposant à leur clientèle des sacs tissés ou des paniers réutilisables, les pâtisseries, boulangeries et épiceries continuent toujours d’emballer leurs produits dans des sacs en plastique.
Chez les petits commerçants, la grogne est à son comble. Depuis vendredi 1er juillet, la commission de contrôle veille au grain. Elle a déjà remis les premières convocations à ceux qui continuent d’utiliser les sachets en plastique. Les services économiques des préfectures auraient même reçu l’ordre de transmettre immédiatement les dossiers d’infraction à la justice.
Cette résistance du sac plastique a plusieurs explications. Ali Boutakka, trésorier national du Syndicat national des professionnels et des commerçants (SNPC), déclare que «contrairement à d’autres réformes, telles que l’immatriculation des motos, le gouvernement n’a pas accordé de sursis. Le temps de sensibiliser les consommateurs, de trouver une alternative en quantité suffisante et de régler le problème des producteurs et vendeurs de sacs».
Le gouvernement a promis de soutenir financièrement la reconversion des unités industrielles. Sauf que bon nombre d’entre elles opèrent dans l’informel et ne sont pas éligibles au programme, sauf à les accepter en tant que «passagers clandestins». Mais l’écosystème des sacs ne se limite pas aux producteurs. «Le seul quartier de Derb Milan compte 126 magasins qui ne vendent que des sacs en plastique. L’interdiction est pour eux synonyme de faillite. Le gouvernement devrait les indemniser pour les aider à se reconvertir eux aussi», ajoute Boutakka.
Les commerçants affirment continuer d’utiliser les sacs en plastique faute d’alternative à des prix abordables et en quantité suffisante. D’abord, les consommateurs n’ont pas l’habitude de payer pour l’emballage. De plus, «les unités de fabrication de sachets en papier ne peuvent pas faire face à la forte demande. Même Casablanca, qui est réputée être bien dotée en tissu industriel, n’est pas en mesure de répondre aux besoins des commerçants en sacs. Que dire des autres régions?» signale Boutakka. Pour le syndicaliste, les ratés de l’après-sac en plastique sont à attribuer à l’impréparation de la société et du tissu industriel.
Source : www.leconomiste.com
|
|
|
 Infection bactérienne ou virale ? Un test suffit pour le dire
Infection bactérienne ou virale ? Un test suffit pour le dire
Selon les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains, un tiers des 154 millions d'ordonnances pour des antibiotiques prescrites chaque année par les médecins lors d'une consultation aux Etats-Unis est inutile.
Mais ces erreurs de prescriptions pourraient bien prendre fin dans les prochaines années. Selon une étude américaine publiés mercredi dans la revue médicale Science Translational Medicine, un test sanguin expérimental pourrait permettre aux médecins de déterminer si une infection est d'origine virale ou bactérienne.
Ces chercheurs, spécialisés en génomique, ont découvert que les caractéristiques de sept gènes se modifient différemment suivant qu'une infection est d'origine bactérienne ou virale. Ces signatures génétiques peuvent être observées par un simple prélèvement sanguin.
Les résultats ont révélé que le test différencie avec une précision de 87% les virus de la grippe, d'un rhinovirus ou d'une bactérie.
Mais plusieurs obstacles restent encore à passer avant la généralisation de ce test. Dans un premier temps, les essais cliniques doivent être étendus pour valider les résultats de l'étude. Ensuite, le test doit pouvoir apporter des résultats de manière rapide, c'est-à-dire en une heure ou moins. Chez les patients souffrant, par exemple, d'une septicémie, le risque de décéder augmente de 6 à 8% chaque heure passée sans antibiotique, expliquent les scientifiques. Actuellement, le test prend de quatre à six heures.
Source : http://www.lesechos.fr
|
|
|
 Une bactérie parasite dans notre salive
Une bactérie parasite dans notre salive
Une nouvelle espèce bactérienne récemment découverte par des chercheurs de l'Université de Washington (États-Unis), qui a la particularité d'être un parasite. Comme ces derniers l'ont expliqué fin juin 2016 lors de la réunion annuelle de l'American Society for Microbiology à Boston, il s'agit de la première bactérie parasite repérée dans l'organisme humain.
Jeff McLean et ses collègues ont découvert cette bactérie, qui n'a pas encore de nom, par hasard, en analysant des échantillons de salive humaine. Quelques spécimens avaient déjà été repérés par d'autres chercheurs auparavant, mais personne n'était parvenu à cultiver cette bactérie en laboratoire. Le problème ? Cette cellule contient un nombre très faible de gènes (700 alors que la plupart des autres bactéries en possèdent quelques milliers), l'empêchant de produire ses propres acides aminés (des éléments indispensables à la fabrications de protéines) : pour survivre, elle doit donc les voler à une autre cellule ! Un comportement tout à fait inédit chez les bactéries.
L'hôte préférentielle de ce parasite serait Actinomyces odontolyticus, une bactérie bien plus volumineuse possédant 2.200 gènes. Dans un premier temps, cette bactérie est capable de tolérer son envahisseur qui se colle à sa surface pour extirper ses acides aminés. Mais plus tard, le parasite "commence à attaquer et tuer l'hôte", précise Jeff McLean. Des trous se formeraient sur la victime, dont le contenu jaillirait hors de la cellule... La mort du parasité ? Probablement, mais les chercheurs n'en ont pas encore le cœur net.
Toutefois, ils ont d'ores et déjà découvert que "des concentrations élevées de l'ADN de cette nouvelle bactérie sont présents chez des personnes souffrant d'une inflammation de la gencive." Actinomyces odontolyticus est connue pour participer à ce phénomène, mais est souvent détruite par les macrophages. Et si, lorsqu'elle est parasitée, Actinomyces odontolyticus échappait au contrôle des macrophages et provoquait quand même une inflammation ? C'est la théorie étudiée actuellement par Jeff McLean, qui a récolté quelques indices en ce sens. Il compte aussi déterminer si ce parasite pousse son hôte à devenir résistant à des antibiotiques, comme la streptomycine. Si cette dernière hypothèse est confirmée, il sera important d'identifier si d'autres bactéries parasites peuples notre bouche.
Source : www.sciencesetavenir.fr
|
|
|
 Vacances : quel impact sur la santé ?
Vacances : quel impact sur la santé ?
Les vacances sont-elles bonnes pour la santé? La réponse semble tenir de l'évidence. Quelques études de longue durée comme celles sur la vaste cohorte de la population de Framingham, suivie depuis 1948, montrent une augmentation du risque d'accidents cardio-vasculaires chez les personnes qui prennent peu de congés. «Mais ces études indiquent aussi que les personnes qui partent régulièrement en vacances ont tendance à avoir un mode de vie globalement plus sain», souligne la chercheuse finlandaise Jessica de Bloom.
«Certaines pathologies chroniques comme l'eczéma, les allergies, l'asthme, s'atténuent ou disparaissent pendant les vacances», rappelle le Pr Yves Roquelaure, médecin du travail (CHU Angers). Mais est-ce dû seulement à l'effet des vacances, ou aussi à l'arrêt de l'exposition professionnelle à des facteurs déclenchant?
C'est peut-être la relation entre santé psychique, bien-être et vacances qui est la plus manifeste. Selon l'enquête du Crédoc, 74 % des personnes qui s'estiment globalement heureuses sont parties en vacances dans l'année, contre seulement 38 % de celles qui ne sont pas parties. Les vacances réduisent le risque de dépression, confirment plusieurs études. L'une d'elles, menée en Suède en 2013, a ainsi montré une baisse des ventes d'antidépresseurs avec l'augmentation, en juillet, du nombre des salariés en vacances. Mais, là encore, des biais sont possibles, comme l'ensoleillement estival qui accroît la production d'un neurotransmetteur à effet antidépresseur, la sérotonine.
Pour réduire ces biais, plusieurs chercheurs comme Jessica de Bloom ont évalué l'état des sujets juste avant, pendant et juste après les vacances. Résultat: celles-ci réduisent bien la fatigue accumulée, les plaintes de santé et améliorent le sentiment de bien-être. Mais cet effet reste modéré et s'efface dans les deux à quatre semaines suivant la reprise du travail.
Source : www.sante-lefigaro.fr
|
|
|
|










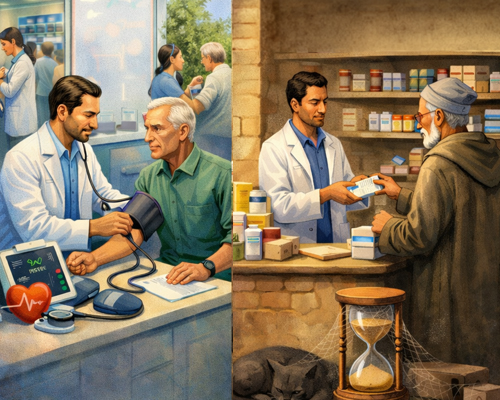
.jpg)
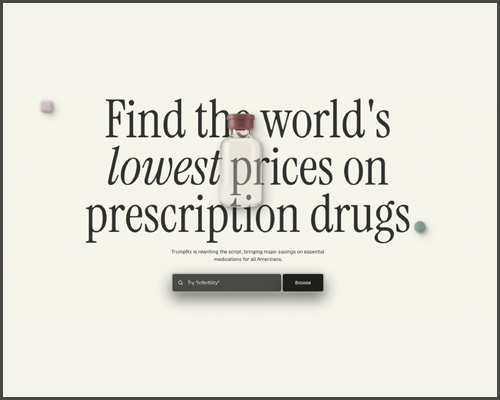
.jpg)